Hey ! Alors vous aussi, vous vous demandez comment investir dans ces fameuses startups dont on entend parler partout ? Vous savez, ces jeunes pousses qui promettent de révolutionner le monde et qui font parfois des x10, x20 ou même plus ? En tant que papa de famille qui jongle entre ses responsabilités et sa passion pour l’investissement, j’ai exploré cette voie via Anaxago, et je vais vous raconter tout ça sans langue de bois.
Investir dans une startup, c’est un peu comme parier sur l’avenir. Certains y voient une opportunité en or, d’autres un casino déguisé. La vérité, comme souvent, se situe quelque part entre les deux. Après avoir investi dans une dizaine de startups via Anaxago ces dernières années, je peux vous dire que c’est un monde fascinant, mais qui demande de la préparation.
Dans cet article, je vais vous expliquer concrètement comment procéder, quelles erreurs éviter, et surtout comment intégrer ce type d’investissement dans une stratégie patrimoniale équilibrée. Parce qu’au final, on est tous là pour faire fructifier notre épargne intelligemment, pas pour flamber notre argent sur des chimères.
Pourquoi investir dans les startups aujourd’hui ?
Franchement, quand j’ai commencé à m’intéresser aux startups, c’était par curiosité plus que par conviction. Les rendements des livrets qui frôlent le zéro, les actions qui font du yoyo, l’immobilier qui devient inaccessible… On cherche tous des alternatives, pas vrai ?
Ce qui m’a vraiment convaincu, c’est de réaliser à quel point notre quotidien est transformé par ces jeunes entreprises. Uber, Airbnb, Deliveroo… Toutes ont commencé comme des startups cherchant des investisseurs. Et ceux qui ont cru en elles dès le début ont fait des gains extraordinaires.
Mais attention, pour chaque success story, combien d’échecs ? C’est là que les plateformes comme Anaxago prennent tout leur sens. Plutôt que d’investir en aveugle, on bénéficie d’une sélection et d’une analyse professionnelle. C’est comme avoir un ami expert qui fait le tri pour nous.
L’autre aspect qui m’attire, c’est la diversification. Mes investissements traditionnels (PEA, assurance-vie, immobilier locatif) me donnent une base stable. Les startups, c’est mon « piment » portfolio, celui qui peut potentiellement faire la différence sur le long terme.
Comment anaxago sélectionne-t-elle ses startups ?
C’est LA question que je me suis posée en premier. Parce que bon, si n’importe qui peut proposer n’importe quoi, ça ne m’intéresse pas. J’ai pas envie de financer le projet farfelu du cousin de la belle-sœur du voisin, si vous voyez ce que je veux dire.
Le processus de sélection d’Anaxago est plutôt rigoureux. D’abord, ils ne retiennent qu’environ 5% des dossiers qui leur sont soumis. Ça veut dire que sur 100 startups qui candidatent, seulement 5 passent le cut. C’est déjà un premier filtre important.
L’équipe d’analystes étudie plusieurs critères : l’équipe dirigeante et son expérience, la taille du marché visé, la différenciation par rapport à la concurrence, le business model, les prévisions financières, et bien sûr la valorisation demandée. Ils rencontrent les fondateurs, visitent les locaux quand c’est possible, et creusent vraiment le dossier.
Ce qui me rassure aussi, c’est qu’Anaxago co-investit souvent avec des fonds professionnels. Quand je vois qu’un fonds spécialisé met aussi son argent sur la table, ça me donne confiance. Ces pros ne rigolent pas avec leurs due diligences.
Bien sûr, ça ne garantit pas le succès. Mais au moins, on part avec des projets qui ont été scrutés sous toutes les coutures par des experts. C’est déjà mieux que d’investir sur un coup de cœur après une présentation de 10 minutes.
Quels sont les différents types de startups proposées ?
Anaxago ne se limite pas à un secteur particulier, et c’est tant mieux pour diversifier. Au fil de mes investissements, j’ai pu explorer différents univers, chacun avec ses spécificités.
Les fintechs représentent une belle part des propositions. J’ai investi dans une solution de paiement mobile et une plateforme de crédit aux entreprises. Ces boîtes bénéficient souvent d’un marché énorme et de barrières à l’entrée intéressantes une fois qu’elles sont établies.
Les startups de la santé et des biotechs sont aussi régulièrement proposées. Plus risquées à cause des cycles de développement longs et des approbations réglementaires, mais avec un potentiel énorme si ça marche. J’ai mis un peu d’argent sur une startup qui développe un dispositif médical innovant.
Côté tech pure, on trouve beaucoup de SaaS (logiciels en ligne), d’intelligence artificielle, et de solutions pour les entreprises. J’avoue avoir un faible pour ces secteurs, peut-être parce que je comprends mieux les enjeux.
L’alimentaire et l’agriculture ne sont pas en reste. Startups de l’agriculture urbaine, alternatives à la viande, nouvelles boissons… C’est un secteur en pleine transformation avec de vraies opportunités.
Combien faut-il investir au minimum ?
Alors là, c’est du concret ! Les tickets d’entrée sur Anaxago varient selon les opérations, mais on peut généralement commencer à partir de 1 000 euros. Personnellement, je trouve que c’est accessible, même si évidemment, ça reste une somme.
Pour mes premiers investissements, j’ai misé entre 2 000 et 5 000 euros par startup. Avec le recul, je pense que c’était une bonne approche. Assez pour que ça compte si ça marche, pas assez pour me ruiner si ça foire.
Maintenant que j’ai plus d’expérience, mes tickets tournent plutôt autour de 5 000 à 10 000 euros. Mais attention, ça c’est parce que j’ai augmenté progressivement mon budget global dédié à ce type d’investissement.
| Profil d’investisseur | Ticket d’entrée conseillé | Budget total startup |
|---|---|---|
| Débutant curieux | 1 000 – 2 000 € | 5 000 – 10 000 € |
| Investisseur confirmé | 3 000 – 8 000 € | 20 000 – 50 000 € |
| Expert diversifié | 5 000 – 15 000 € | 50 000 € et plus |
La règle d’or que je me suis fixée : jamais plus de 2% de mon patrimoine total sur une seule startup. Et jamais plus de 10% de mon patrimoine total sur l’ensemble de mes investissements startup. Ça me permet de dormir tranquille.
Comment analyser une opportunité d’investissement ?
C’est probablement la partie la plus délicate pour nous, investisseurs particuliers. On n’a pas les moyens d’une due diligence complète comme les fonds pros. Mais on peut quand même appliquer quelques réflexes pour éviter les pièges les plus évidents.
D’abord, je regarde toujours l’équipe dirigeante. Dans une startup, les fondateurs font 80% du succès. Leur expérience, leur complémentarité, leur capacité à pivoter quand nécessaire… Je cherche des profils qui ont déjà créé des entreprises, même si elles n’ont pas toutes été des succès fous.
Ensuite, je m’attarde sur le marché. Une startup géniale sur un marché de niche de 10 millions d’euros, ça limitera toujours le potentiel. À l’inverse, une solution « moyenne » sur un marché de plusieurs milliards peut très bien s’en sortir.
La concurrence est cruciale à analyser. Si la startup prétend révolutionner un secteur où personne n’a jamais pensé à leur solution, ça me fait tiquer. Soit ils ont trouvé LA pépite que personne n’a vue, soit il y a une raison pour laquelle personne ne l’a fait.
Je regarde aussi attentivement le business model. Comment l’entreprise va-t-elle gagner de l’argent ? Quand ? Avec quelle récurrence ? Les modèles par abonnement (SaaS) me rassurent plus que les modèles transactionnels purs.
Quels sont les risques à connaître absolument ?
Soyons clairs : investir dans des startups, c’est risqué. Très risqué même. Si quelqu’un vous dit le contraire, fuyez ! Mais risqué ne veut pas dire stupide, à condition de bien mesurer ces risques.
Le premier risque, c’est la perte totale du capital. Contrairement à une action cotée qui peut perdre 90% mais garder une valeur résiduelle, une startup qui fait faillite, c’est zéro pointé. J’ai vécu ça deux fois sur mes investissements, et même si on s’y prépare mentalement, ça fait mal au portefeuille.
L’illiquidité est un autre aspect majeur. Votre argent est bloqué pour plusieurs années, parfois 5 à 10 ans. Impossible de revendre vos parts si vous avez besoin de cash rapidement. C’est pourquoi il faut absolument investir de l’argent dont on n’aura pas besoin à court terme.
La dilution peut aussi réduire vos gains. Si la startup lève des fonds supplémentaires à une valorisation qui ne suit pas, votre pourcentage de participation diminue. C’est mathématique et parfois douloureux.
Il y a aussi des risques plus spécifiques selon les secteurs. Risque réglementaire pour les fintechs, risque technologique pour les deeptech, risque de marché pour les produits de consommation… Chaque domaine a ses particularités.
Quelle stratégie adopter pour ses premiers investissements ?
Après avoir testé différentes approches, j’ai fini par développer une méthode qui me convient. L’idée, c’est d’y aller progressivement, d’apprendre de ses erreurs, et surtout de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier.
Ma stratégie actuelle ressemble à ça : je consacre maximum 10% de mes investissements financiers aux startups. Sur cette enveloppe, je diversifie sur au moins 8 à 10 startups différentes. Statistiquement, on sait qu’en venture capital, 70% des investissements perdent de l’argent, 20% font du break-even, et 10% font les gros gains qui compensent tout le reste.
Je privilégie les secteurs que je comprends un minimum. Pas besoin d’être expert, mais avoir une idée des enjeux aide à mieux évaluer les opportunités. C’est pourquoi j’investis beaucoup dans la fintech et le SaaS B2B.
Côté timing, j’étale mes investissements sur plusieurs mois. Plutôt que d’investir 30 000 euros d’un coup sur trois startups, je préfère investir 5 000 euros tous les deux mois. Ça lisse les valorisations et me permet de profiter des différentes opportunités qui se présentent.
Je tiens aussi un tableau de suivi avec mes investissements, les news des entreprises, les levées de fonds ultérieures… Ça m’aide à garder un œil sur mes participations et à tirer des enseignements pour la suite.
Comment suivre l’évolution de ses investissements ?
C’est un point important que beaucoup négligent. Contrairement aux actions cotées qu’on peut suivre en temps réel, les startups demandent une approche différente. L’information est moins fréquente et moins standardisée.
Anaxago envoie régulièrement des updates sur les startups de leur portefeuille. Chiffres d’affaires, levées de fonds, partenariats, difficultés… Ces rapports sont précieux pour suivre l’évolution des entreprises dans lesquelles on a investi.
Je consulte aussi directement les sites web et réseaux sociaux des startups. On y trouve souvent des infos intéressantes sur les nouveaux clients, les embauches, les pivot stratégiques… C’est un bon moyen de prendre le pouls de l’entreprise.
Les plateformes spécialisées comme Frenchweb ou les newsletters startup donnent aussi une vision d’ensemble du marché. Ça aide à contextualiser les performances de ses investissements.
Mais attention à ne pas tomber dans l’obsession du suivi quotidien. Ces investissements se jugent sur plusieurs années. Vouloir avoir des nouvelles toutes les semaines, c’est le meilleur moyen de se stresser pour rien.
Mes plus belles réussites et mes échecs cuisants
Bon, maintenant que j’ai planté le décor, laissez-moi vous raconter du concret. Parce que c’est bien beau la théorie, mais qu’est-ce que ça donne dans la vraie vie ?
Ma plus belle réussite, c’est un investissement de 6 000 euros dans une fintech qui développait une solution de paiement pour les marketplaces. En 3 ans, l’entreprise a été rachetée par un acteur majeur du secteur. Retour sur investissement : 8x, soit 48 000 euros. Pas mal pour un ticket d’entrée relativement modeste !
À l’inverse, j’ai perdu intégralement 4 000 euros sur une startup de l’alimentaire qui voulait révolutionner les snacks sains. Belle idée sur le papier, équipe motivée, mais l’exécution n’a pas suivi. La concurrence était plus féroce que prévu, et ils n’ont jamais réussi à trouver leur place sur le marché.
Une autre déception, c’est une startup de la mobility qui promettait des vélos électriques révolutionnaires. Après deux ans, ils existent toujours, mais l’entreprise peine à décoller. Mon investissement de 5 000 euros vaut probablement moins de 1 000 euros aujourd’hui. Pas mort, mais pas brillant non plus.
Ces expériences m’ont appris l’importance de la diversification. Si j’avais mis tout mon budget sur la startup alimentaire, j’aurais pleuré. Mais grâce à la fintech qui a bien marché, mon bilan global reste largement positif.
Combien de temps faut-il attendre avant de voir des résultats ?
Ah, la patience ! C’est probablement la qualité la plus importante pour investir dans les startups. Si vous êtes du genre à vérifier votre portefeuille tous les matins et à stresser sur les variations, passez votre chemin.
En moyenne, il faut compter 5 à 7 ans pour voir le dénouement d’un investissement startup. Certaines peuvent être rachetées plus rapidement (2-3 ans), d’autres peuvent mettre 10 ans avant d’aboutir à une sortie.
Mes premiers investissements sur Anaxago datent de 2019. Aujourd’hui, en 2025, je commence à avoir un vrai recul. Certaines startups ont déjà été vendues, d’autres lèvent des tours supplémentaires, et quelques-unes ont malheureusement disparu.
Le piège, c’est de vouloir des résultats trop rapidement. Une startup qui ne décolle pas en 18 mois n’est pas forcément vouée à l’échec. Beaucoup d’entreprises aujourd’hui valorisées des milliards ont mis du temps à trouver leur modèle.
C’est pourquoi je considère cet argent comme « bloqué » dès le départ. Dans ma tête, c’est de l’argent que je n’ai plus, point. Si ça marche bien, tant mieux, ce sera du bonus. Cette approche mentale m’évite de me ronger les sangs.
Est-ce que les avantages fiscaux valent le coup ?
Question importante ! Certains investissements startup ouvrent droit à des réductions d’impôts via le dispositif IR-PME. Concrètement, on peut déduire 25% de son investissement de ses impôts, dans la limite de 50 000 euros pour un célibataire (100 000 euros pour un couple).
Sur le papier, c’est très attractif. Investir 10 000 euros et récupérer 2 500 euros d’économie d’impôt, ça réduit significativement le risque. Même si la startup fait faillite, on ne perd « que » 7 500 euros nets.
Dans la pratique, c’est un peu plus compliqué. Toutes les startups ne sont pas éligibles au dispositif IR-PME. Il faut qu’elles respectent certains critères : moins de 250 salariés, création récente, activité réelle… Anaxago indique clairement quand un investissement est éligible.
Attention aussi à la durée de détention. Pour bénéficier de la réduction d’impôt, il faut conserver ses parts au moins 5 ans. Si on revend avant, on doit rembourser l’avantage fiscal. Ça tombe bien, de toute façon on n’a généralement pas le choix !
Personnellement, je considère l’avantage fiscal comme un bonus, pas comme la raison principale d’investir. Un mauvais investissement avec une réduction d’impôt reste un mauvais investissement.
Comment intégrer les startups dans sa stratégie patrimoine ?
C’est LA question stratégique. Parce qu’investir dans des startups, c’est sympa, mais ça doit s’inscrire dans une démarche patrimoniale cohérente. On ne fait pas ça pour frimer au dîner avec les copains (enfin, pas que).
Dans ma répartition d’actifs, les startups représentent environ 8% de mon patrimoine financier total. C’est suffisant pour avoir un impact significatif si ça marche bien, mais pas assez pour compromettre ma situation financière si ça se passe mal.
Le reste de mes investissements se répartit entre actions cotées (40%), obligations et fonds euros (25%), immobilier locatif (20%), et liquidités (7%). Cette base « classique » me donne la sécurité nécessaire pour prendre des risques sur les startups.
Je considère les investissements startup comme la partie « croissance agressive » de mon portefeuille. Celle qui peut potentiellement faire exploser les performances, mais qui peut aussi tout perdre. C’est mon pari sur l’avenir, ma participation à l’économie de demain.
L’important, c’est de garder des proportions raisonnables et de ne jamais remettre en cause ses objectifs patrimoniaux principaux (retraite, transmission, revenus complémentaires) pour financer des investissements risqués.
Mes conseils pour bien débuter sur anaxago
Après toutes ces explications, voici mes conseils concrets pour ceux qui voudraient se lancer. Parce que c’est bien beau de raconter ses expériences, mais il faut aussi donner du pratique !
Commencez petit et progressivement. Fixez-vous un budget global (par exemple 10 000 euros) et investissez par tranches. 2 000 euros sur une première startup, puis 2 000 euros sur une deuxième trois mois plus tard, etc. Cette approche vous permet d’apprendre sans risquer gros.
Lisez attentivement tous les documents fournis par Anaxago. Business plan, présentation, Q&A avec les fondateurs… Plus vous comprenez l’entreprise, mieux vous pourrez évaluer l’opportunité. N’hésitez pas à poser des questions via la plateforme.
Diversifiez dès le départ. Même avec un petit budget, essayez d’investir sur au moins 3-4 startups différentes. Si possible dans des secteurs variés. Ça limite les risques de concentration.
Tenez un tableau de suivi de vos investissements. Date, montant, secteur, stade de développement… Ça vous aidera à analyser vos choix et à améliorer votre stratégie.
Rejoignez les communautés d’investisseurs. Il existe des groupes Facebook, des forums, des événements où échanger avec d’autres investisseurs particuliers. C’est enrichissant et ça évite de se sentir seul dans cette aventure.
Enfin, préparez-vous psychologiquement aux échecs. Ils font partie du jeu. L’important, c’est d’apprendre de chaque expérience pour s’améliorer.
Disclaimer : Cet article présente un retour d’expérience personnel et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Les investissements dans les startups présentent des risques élevés de perte en capital. Il est essentiel de diversifier ses investissements et de ne jamais investir plus que ce que l’on peut se permettre de perdre. Avant tout investissement, consultez un conseiller financier qualifié et lisez attentivement tous les documents d’information fournis par les plateformes.

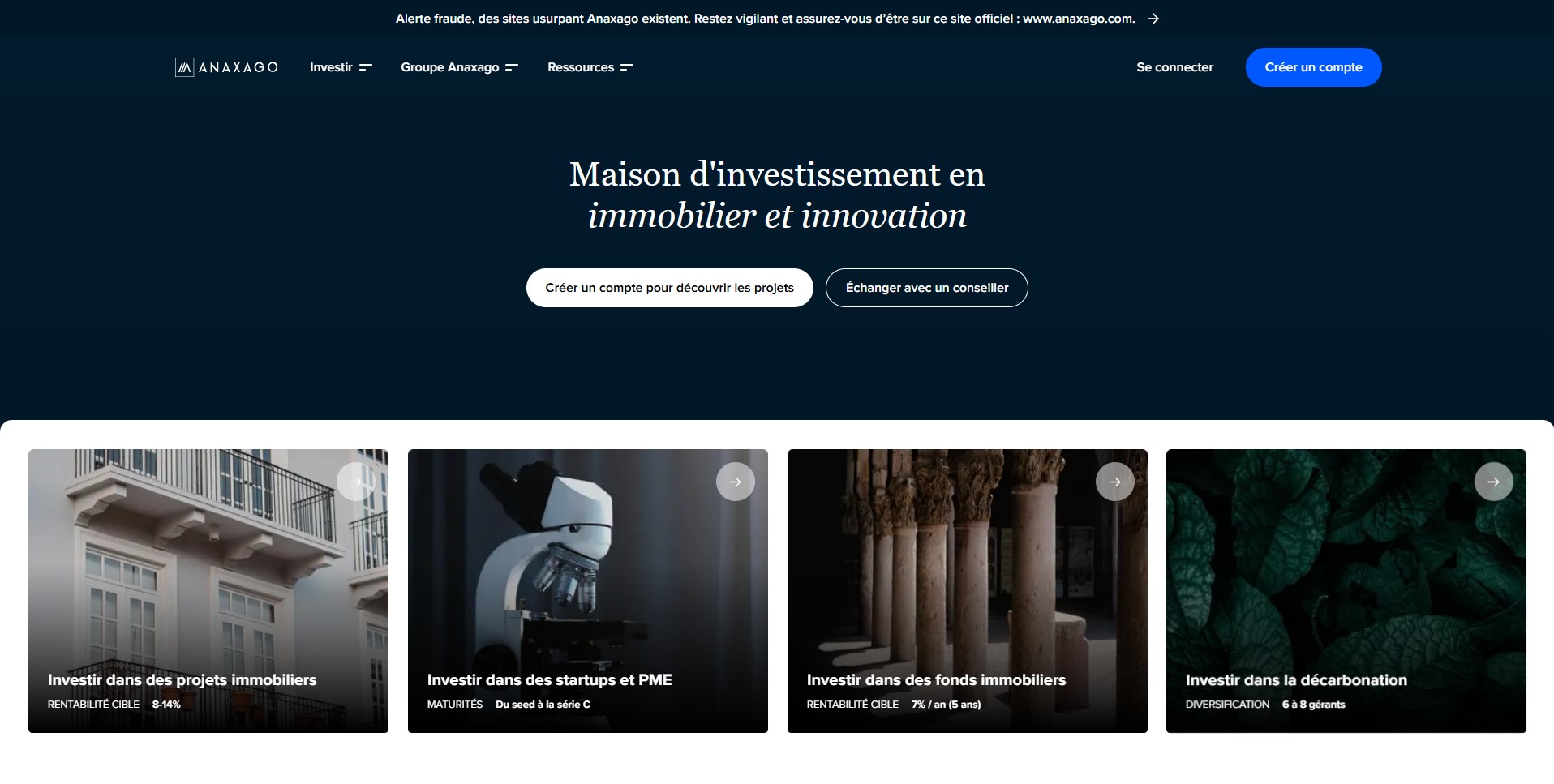
0 Comments